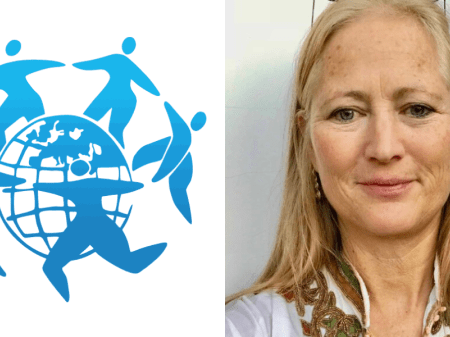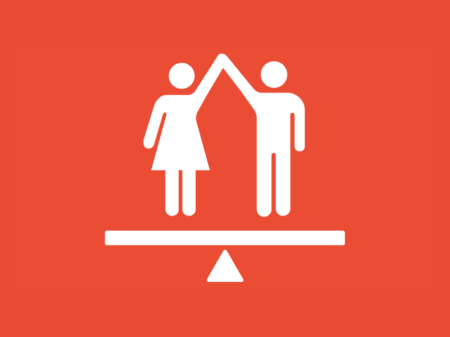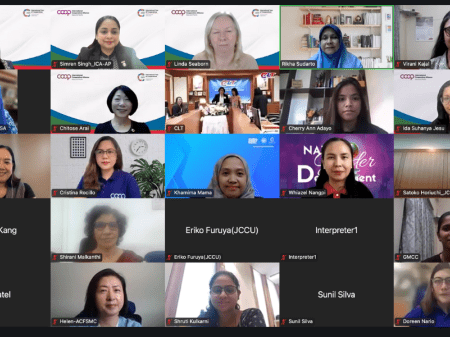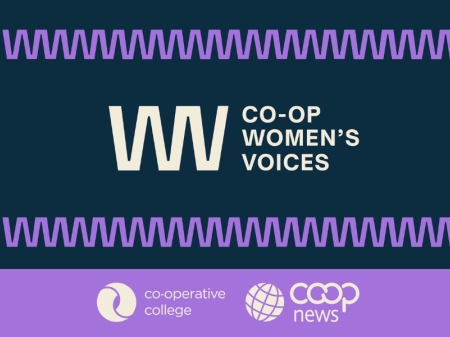Women Engage for a Common Future [Femmes engagées pour un avenir commun (WECF International)] œuvre en faveur du plaidoyer politique et apporte un soutien concret aux coopératives durables et respectueuses de l'égalité des genres dans 70 pays. Nous avons discuté avec Sasha Gabizon, directrice exécutive, de la manière dont elle perçoit le modèle coopératif comme bénéfique pour les femmes de différents secteurs, améliorant leurs droits et leur accès au financement et, in fine, contribuant à l'ODD 5.
ACI : Vous êtes la directrice exécutive de Women Engage for a Common Future. Pouvez-vous nous parler de votre travail ?
Sasha Gabizon : Nous sommes un réseau écoféministe international. Nous avons des partenaires qui sont des organisations féministes et qui travaillent ensemble sur l’environnement et le climat dans 70 pays. Nous connaissons très bien l’ACI car nous travaillons dans des espaces politiques similaires pour le développement durable et l’égalité des genres. Nous menons de nombreuses actions de plaidoyer et d’analyse politique et nous utilisons les Objectifs de développement durable comme ligne directrice et ambition pour nos réalisations. Mais nous menons également un travail pratique important. Nous aidons les organisations locales à créer des alternatives justes et durables en matière de genre ce qui peut inclure la création de coopératives. Nous avons également des bureaux dans plusieurs pays d’Europe d’où nous soutenons le réseau dans le monde entier. Nous avons un bureau aux Pays-Bas, qui est notre plus ancien bureau (nous venons d’avoir 30 ans), ainsi qu’en Allemagne, en France et en Géorgie.
ACI : Comment voyez-vous l'implication des coopératives dans votre travail et comment le partenariat avec l’ACI peut-il vous y aider ?
S. G. : Nous sommes tous conscients du réel problème du statu quo et nous pensons qu'un modèle plus juste socialement, comme le modèle coopératif, est bien plus durable, inclusif et efficace parce qu’il ne génère pas de profits très élevés pour les actionnaires et qu’il est plus démocratique. Je pense que c'est probablement le plus important parce que, comme nous le constatons aujourd'hui, avoir des gouvernements fortement influencés par de riches milliardaires n'est évidemment pas très démocratique. Un modèle bien plus avantageux est celui d'une coopérative dont on devient membre et où, tous ensemble, on investit dans le développement d'entreprises durables. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu les coopératives et que nous aimons également promouvoir le modèle coopératif auprès de nos partenaires.
Ainsi, nous travaillons beaucoup avec les femmes qui font partie de coopératives agricoles (qu'elles soient exclusivement féminines ou mixtes) et avec celles qui travaillent dans des coopératives d'énergies renouvelables comme modèle pour la transition énergétique. Nous constatons que le seuil d'engagement dans l'économie sociale est bien plus bas avec le modèle coopératif et pour les femmes qui ont souvent moins accès au financement et au capital. Devenir membre d'une coopérative est plus facile pour une femme que devenir actionnaire d'une grande entreprise. Ce modèle a fait ses preuves mais je pense qu'il manque encore de soutien politique et que nous devons absolument nous battre pour que le modèle coopératif soit perçu comme probablement la meilleure alternative pour le développement durable à l'échelle mondiale.
ACI : Pouvez-vous nous donner des exemples de coopératives avec lesquelles vous avez travaillé et qui ont réellement fait la différence pour les femmes concernées et leurs communautés ?
S. G. : Bien sûr. Nous travaillons avec les organisations de femmes rurales en Ouganda qui soutiennent les femmes dans l’agriculture. Leur principal défi réside dans les droits des femmes et le contrôle foncier et dans la recherche de solutions aux cas où, même après héritage, des terres peuvent être confisquées par des hommes de la famille, des oncles ou des cousins. Garantir le contrôle et les droits fonciers d’une agricultrice individuelle est souvent plus compliqué qu’en coopérative ; une coopérative offre davantage de soutien et de sécurité ainsi qu’un meilleur contrôle sur les revenus et les investissements. De nombreuses agricultrices ougandaises n’avaient pas d’épargne ou de compte bancaire. Aujourd’hui c’est plus facile grâce à Safaricom et à d’autres services bancaires en ligne qui permettent d’épargner jusqu’à environ 1 000 dollars. Mais même cela reste un moyen limité pour les femmes d’accéder aux financements d’investissement. Grâce aux coopératives, il est possible d'organiser l'accès aux banques et aux prêts. De fait, l'épargne et le crédit sont au cœur de nombreuses coopératives agricoles parce que c'était le principal défi pour les agricultrices. Nous avons ajouté des formations et investi dans les énergies renouvelables, comme des panneaux solaires photovoltaïques pour un accès gratuit à l'électricité, ce qui a également donné un coup de pouce considérable puisque cela permet également d'accéder à Internet et aux informations sur les marchés. Nous avons investi environ 8 000 dollars au total dans les panneaux solaires, ce qui suffit à faire fonctionner le bureau de la coopérative et à permettre à toutes les femmes de la communauté de venir recharger leurs téléphones et d'avoir accès à Internet. Nous avons également travaillé avec elles sur la réduction des achats de pesticides toxiques qui représentent un coût financier mais aussi un risque pour la santé.
ACI : Comment voyez-vous le modèle coopératif accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable – pas seulement l’ODD 5 mais l’ensemble de ces Objectifs en tant qu’écosystème cohérent ?
S. G. : Vous avez des coopératives dans de nombreux secteurs différents. Les ODD concernent l’énergie, la consommation et la production durables, l’agriculture et l’éradication de la faim. Ils s’intéressent également à l’eau et à l’assainissement ainsi qu’aux emplois décents et au développement économique. Dans tous ces domaines, le modèle coopératif peut jouer un rôle moteur et contribuer à accélérer leur réalisation.
Nous constatons une réaction négative de la part des gouvernements d’extrême droite au pouvoir dans plusieurs pays, dont le mien, aux Pays-Bas, où les fonds destinés à la société civile et au développement de la coopération sont réduits et où le gouvernement affirme que la seule solution réside dans les entreprises. Et là encore, « Oui, mais vous avez aussi une entreprise sociale et responsable, et vous avez le modèle coopératif, et cela peut nous aider à atteindre ces Objectifs de développement durable ».
J'ai le sentiment que [pour l'ODD 5], nous constatons encore dans certains pays la nécessité d'une plus grande parité dans le nombre de femmes membres de coopératives, notamment dans des domaines plus techniques comme les énergies renouvelables, ainsi que dans les postes de direction, de gestion ou de conseil d'administration. Nous constatons déjà un travail important dans ce domaine : j'ai des collègues qui travaillent avec les coopératives européennes d'énergie renouvelable sur ces questions. Bien sûr, il est également nécessaire de collaborer avec les municipalités et les gouvernements parce que cela commence en grande partie à l'école et dans le système éducatif.
ACI : Le 8 mars c’était la Journée internationale des femmes et, en 2025, le thème était « Accélérer l’action ». Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
S. G. : À l’heure actuelle, nous constatons que nous sommes encore à 150 ans, voire plus, de l’égalité des genres si nous continuons à ce rythme. Nous devons donc prendre des mesures pour accélérer l’égalité des genres dans tous les domaines de nos sociétés, y compris dans le secteur économique. Nous constatons un recul avec la diminution du nombre de femmes au gouvernement. Nous devons donc redoubler d’efforts non seulement pour enrayer ce recul, mais aussi pour accélérer les progrès vers l’égalité des genres dans ces domaines. Nous savons qu’il existe de nombreux instruments et outils qui peuvent nous y aider, non seulement par l’éducation et la formation mais aussi par l’organisation de votre coopérative par exemple. Souhaitez-vous avoir une coopérative paritaire ? En avez-vous l’objectif ? Souhaitez-vous une codirection composée de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre au sein de vos conseils d’administration ou de vos équipes de direction ? Ensuite, il faut déterminer comment approcher les clients potentiels ou collaborer avec les partenaires en amont et en aval. Pouvez-vous également faire la différence dans ce domaine ? Pourriez-vous essayer d'élaborer une stratégie spécifique pour impliquer davantage de femmes en aval ou en amont de votre chaîne de valeur par exemple ? Nous pouvons donc faire beaucoup de choses et beaucoup sont déjà en cours. Mais nous pouvons les intensifier.
ACI : Vous avez participé à la quatrième Conférence mondiale des femmes à Pékin en 1995. Cette année marque le 30e anniversaire de la Déclaration de Pékin et du Programme d’action pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. Quels progrès avez-vous constatés ?
S. G. : La période actuelle n’est pas facile mais bien sûr d’énormes progrès ont été réalisés. Une grande partie de ces progrès est due à l’amélioration des politiques ; nous avons collaboré avec le mouvement coopératif et d’autres groupes de la société civile ainsi qu’avec des syndicats, etc. Je pense que les changements les plus importants que nous avons observés ont eu lieu dans des pays partenaires comme le Kenya où l’égalité des genres est devenue l’un des principes fondamentaux de la Constitution. Ou en France, où le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sûre et légale est désormais inscrit dans la Constitution. Ce sont des mesures sur lesquelles il est beaucoup plus difficile de revenir parce qu’une fois inscrites dans la Constitution elles ont beaucoup plus de poids. Nous avons également constaté un travail remarquable sur les droits fonciers des agricultrices ainsi que sur la réglementation et la légalisation des modèles coopératifs et de la société civile qui n'existaient pas dans tous les pays il y a 30 ans.
Et tout cela est dû en grande partie à ce processus lancé il y a 30 ans à Pékin, où, pour la première fois, tous les États membres de l'ONU ont adopté ce programme véritablement ambitieux.
Mais nous constatons dans certains pays un profond recul où, par exemple, la société civile est interdite. Comme en Géorgie, où nous avons un bureau, le gouvernement pro-russe a pris des mesures qui obligent à fermer les organisations de la société civile.
On peut obtenir des progrès économiques pour les femmes, comme l'accès aux comptes bancaires et aux droits fonciers, mais si l'on ne s'attaque pas également aux obstacles, à la discrimination et aux stéréotypes sous-jacents, les progrès seront limités et peu durables. C'est pourquoi nous devons également promouvoir les droits sexuels et reproductifs des femmes et leur autonomie corporelle, leur permettre de planifier leur famille, d'avoir accès à des contraceptifs et de mettre fin au mariage des filles mineures. Il faut prendre ces mesures en parallèle sinon ce ne sera pas durable.
Je pense donc que nous avons heureusement constaté de nombreux progrès dans de nombreux pays du monde et même si certains reculent, nous allons nous mobiliser et résister.
ACI : Selon vous, quels sont les besoins les plus urgents à combler et comment les coopératives peuvent-elles y contribuer ?
S. G. : Je pense que les obstacles structurels sont souvent invisibles. C’est pourquoi, même au sein des coopératives, il est très utile de réaliser une analyse organisationnelle de l’égalité des genres et d’analyser nos pratiques. Existe-t-il des obstacles structurels sous-jacents dont nous ignorions l’existence ? Par exemple, j’ai visité des coopératives de floriculture au Kenya. Elles ont opéré un changement majeur en mettant en place un comité pour l’égalité des genres, doté d’un mécanisme de plainte et de mesures immédiates en cas de violences sexuelles et sexistes. Grâce à ces mesures, à la création du comité pour l’égalité des genres et à la présence de femmes à des postes de direction, elles ont profondément transformé leur organisation.
Les violences sexuelles et sexistes au travail sont un véritable tabou. Nous avons constaté, avec le mouvement #MeToo, que ce phénomène se produit partout, en Europe, aux États-Unis, dans les universités, les entreprises et au sein du gouvernement. Il est donc essentiel d’en faire un sujet de discussion afin d’apporter un changement positif et bénéfique à votre coopérative.
ACI : Le thème de l’Année internationale des coopératives 2025 est « Les coopératives construisent un monde meilleur ». D’après votre expérience, comment voyez-vous les coopératives œuvrer dans ce sens ?
S. G. : Vous avez des coopératives de toutes tailles et de toutes formes, et toutes ne sont pas axées sur le développement durable. Par exemple, je viens d’un pays où il existe de très grandes coopératives laitières ou bancaires qui, au fond, n’ont pas toujours été très respectueuses de l’environnement, du climat ou de la durabilité environnementale. Mais je pense que le mouvement coopératif a fait bien plus que les entreprises traditionnelles. Il existe de nombreuses bonnes pratiques et études de cas, et je pense qu’un aspect important de votre travail à l’ACI est de partager ce qui a été fait afin que d’autres puissent en tirer des enseignements et améliorer leurs pratiques. Un travail formidable est accompli mais il reste encore beaucoup à faire.