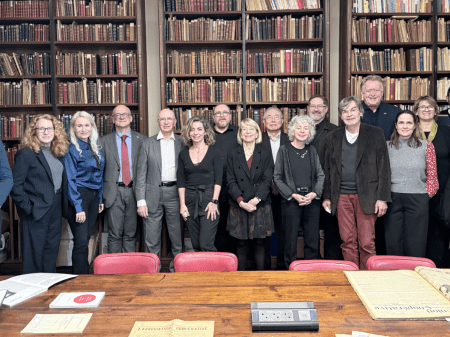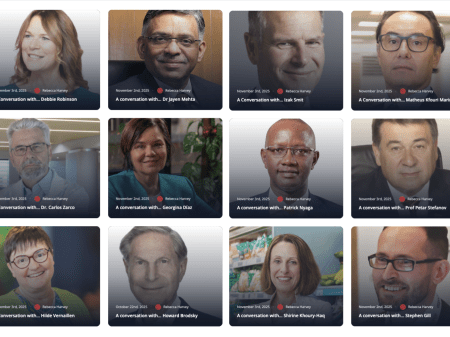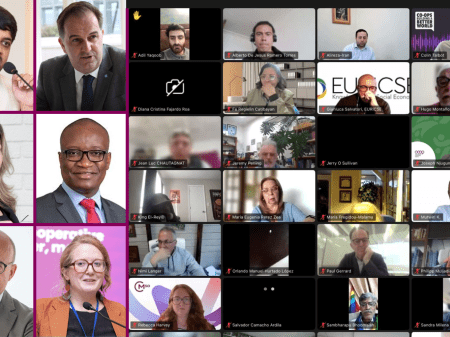La situation pour les coopératives semble n'avoir jamais été aussi prometteuse en termes de reconnaissance.
L’Organisation internationale du travail, dans un de ses rapports réalisé en 2009, souligne la résilience des banques coopératives en période de crise, ces dernières se caractérisant par leur stabilité et leur aversion aux risques (Birchall et Ketilson, 2009)[1]. L'OIT a également mené une étude sur la résistance des banques coopératives qui met en évidence qu'entre 2007 et 2010, leurs actifs ont augmenté de 10 % et que leur clientèle a, elle, augmenté de 14 %[2].
Le Fonds monétaire international voit, quant à lui, dans les banques coopératives des acteurs qui créent une relation forte et de confiance avec les membres et une pression à la baisse sur les prix proposés par tous les acteurs bancaires. La forme coopérative permet ainsi de créer du lien avec ses membres et de contenir les prix et favorise ainsi un meilleur accès aux produits financiers (Fonteyne, 2007). Ces organisations voient ainsi dans les banques coopératives des acteurs importants de stabilisation.
Si les banques coopératives sont aujourd'hui reconnues et bien identifiés, trois défis majeurs sont à mener dans la gouvernance. Le premier est de maintenir une existence de la démocratie et ce au niveau local pour préserver la dimension de proximité qui donne tout son sens à l'engagement des sociétaires dans la gouvernance. Le deuxième est de veiller à ce que les sociétaires occupent toujours une place dans la gouvernance sans être marginalisés par la direction salariée. Enfin, le troisième vise à mieux définir les fonctions des élus du conseil d'administration et de mieux les accompagner, notamment par la formation.
La démocratie de proximité réinterrogée par des groupes en croissance
Le deuxième principe de l'Alliance coopérative internationale sur le "Pouvoir démocratique exercé par les membres" stipule que "les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vertu de la règle : un membre, une voix"[3].
Ce principe met en lumière la dimension de proximité, de participation des membres à la décision et à l'orientation de l'organisation et ce de manière égalitaire selon la règle "une personne, une voix".
La croissance des banques coopératives entraîne un éloignement du coopérateur de la décision finale. Son poids décisionnel se dilue avec l'augmentation du nombre de membres, il n'existe pas de mécanismes, comme les sociétés commerciales sous formes de sociétés anonymes connaissent avec les "pilules empoisonnées", permettant aux coopérateurs historiques de conserver un pouvoir supérieur aux nouveaux. De plus, la croissance de groupes bancaires va multiplier les niveaux des décisions au fur et à mesure que le groupe se développe. D'un niveau local à un niveau régional, du régional au national, le pouvoir a alors tendance à se transférer. La règle reste néanmoins celle d'un pouvoir basé sur le principe de la subsidiarité: ce qui techniquement, économiquement ne peut être réalisé à un niveau de l'organisation remonte au niveau supérieur, ainsi de suite. Or, ce principe peut amener à une centralisation du pouvoir avec un transfert régulier des décisions au niveau central pour des questions de rentabilité, d'efficacité ou encore de nécessaire mutualisation de moyens. Si cela s'avère nécessaire, surtout pour renforcer l'organisation sur un marché concurrentiel, il faut néanmoins veiller à ne pas déposséder le niveau local de son rôle. L'enjeu est crucial aujourd'hui pour les banques coopératives de donner, ou de redonner pleinement au niveau local, celui où la légitimité est la plus forte, son rôle. Ne pas laisser de place à la démocratie locale revient à se couper des membres qui ne verront plus dans la banque coopérative qu'une banque classique et qui ne s'engageront plus dans sa gouvernance. Cela reviendrait inévitablement à diminuer le nombre de participants aux Assemblées générales et conduirait à l'atrophie de l'expression démocratique. Cela aurait également pour effet d'assécher en quantité et qualité le vivier de dirigeants élus qui potentiellement pourrait prendre des fonctions de haut niveau dans la gouvernance de la banque coopérative. Le niveau local est ainsi à réinventer en redonnant de vrais missions aux élus locaux ce qui sera la meilleure garantie d'une gouvernance efficace et ce à tous les niveaux de la coopérative.
Des dirigeants responsables et de haut niveau
Afin de disposer de dirigeants de haut niveau et responsables, deux éléments sont à aborder. Tout d'abord, leur positionnement et leur rôle doit être mieux défini pour éviter qu'ils se retrouvent évincés de la gouvernance de l'organisation. Ensuite, cela signifie qu'il faudra nécessairement les accompagner à exercer au mieux leurs fonctions, la formation est alors une réponse pour cet enjeu.
Un des enjeux majeurs est, à nos yeux, celui de la redéfinition de la fonction de dirigeant élu dans les organisations coopératives et plus particulièrement dans les banques coopératives. Certaines dérives de ces dernières années peuvent laisser entrevoir que les dirigeants élus n'ont pas joué leur rôle de contre pouvoir, notamment dans des investissements hasardeux dans des pays à risques. Nous pourrions aller plus loin en soulignant que certaines dérives tiennent aussi aux dirigeants élus qui n'ont pas totalement tenu la place qui était la leur. Il est indispensable que soit clairement redéfini le rôle du dirigeant élu. Objectivement, il ne peut pas entrer dans l'ensemble des circuits opérationnels. Ce n'est clairement pas son rôle, il viendrait en effet perturber la fonction dévolue au Directeur général. En revanche, il doit être en capacité de se positionner sur deux axes majeurs en gouvernance qui sont celui de la décision et du contrôle que la décision a été mise en œuvre. Le dirigeant élu est ainsi un stratège et à la fois un contrôleur. Il est également garant des intérêts des membres, il doit donc être sur des missions d'animation du mouvement des membres, et donc de la démocratie. Il porte un mandat, ce qui signifie qu'il doit rendre compte devant ses pairs, c'est à dire des membres en Assemblée générale, du mandat qui lui a été donné. L'assemblée générale, dite souveraine, est elle même dans les mêmes fonctions que le dirigeants : elle décide des orientations et les contrôle. Le dirigeant n'agit alors qu'en délégation de pouvoir des membres de la coopérative. Cet élément de base dans la gouvernance coopérative est néanmoins fondamental car il précise simplement mais clairement les rôles de chacun. Le dirigeant élu, le président de la banque coopérative doit alors être un stratège capable d'éclairer sur les orientations à prendre, il est garant de la décision et du contrôle et ce pour le compte des membres coopérateurs.
Après la définition du rôle de dirigeant élu, doit se poser la question de ses compétences. Les membres du conseil d'administration accèdent à ces fonctions à la suite d'un long engagement dans la coopérative ou le mouvement coopératif. Cette fonction est alors exercée après un apprentissage de long terme et de nature pragmatique. Or, face aux différents enjeux actuels, et si les dirigeants veulent réaliser efficacement leur mission de décision et de contrôle, il apparaît nécessaire d'imaginer des parcours de formation. Si certains émergent aujourd'hui[4] ces initiatives doivent être renforcées et permettre des temps de rencontre plus réguliers sur ces questions favorisant l'échange autour des réalités que chacun rencontre dans sa structure et son pays. Ces mutualisations permettront d'éclairer sur ce que seront nos dirigeants de banque coopérative demain
De la crise au réveil de la démocratie coopérative
De la crise est née la prise de conscience de la nécessité de se démarquer, de revenir sur les bases fondamentales des banques coopératives, à savoir le sociétaire. "Considéré comme un handicap durant les années de financiarisation, le "sociétariat" est de retour dans les banques mutualistes et coopératives depuis que la crise financière a miné la confiance dans le système bancaire, et en particulier dans la gouvernance des établissements" (Gomez, 2013). Cette prise de conscience divise alors et fait débat (Frémeaux, 2011). Certains voient dans cette nouvelle attitude une démarche marketing, commerciale visant à se distinguer des concurrents voire à se regagner en pureté. D'autres, comme les banques coopératives elles-mêmes redécouvrent une dimension qu'elles avaient égarée et qui leur permet de reconstruire une confiance altérée par la crise et les investissements spéculatifs bien éloignés des préoccupations des sociétaires. La reconquête passe, et ne pourra que passer par le fait de retisser du lien avec les sociétaires, regagner les positions de proximité qui faisaient des banques coopératives, et des coopératives dans leur ensemble, la base de leur légitimité. Au plus proche des sociétaires, de leurs besoins, de leurs attentes et de leur vote. Ces organisations De la crise est née la prise de conscience de la nécessité de se démarquer, de revenir sur les bases fondamentales des banques coopératives, à savoir le sociétaire. "Considéré comme un handicap durant les années de financiarisation, le "sociétariat" est de retour dans les banques mutualistes et coopératives depuis que la crise financière a miné la confiance dans le système bancaire, et en particulier dans la gouvernance des établissements" (Gomez, 2013). Cette prise de conscience divise alors et fait débat (Frémeaux, 2011). Certains voient dans cette nouvelle attitude une démarche marketing, commerciale visant à se distinguer des concurrents voire à se regagner en pureté. D'autres, comme les banques coopératives elles-mêmes redécouvrent une dimension qu'elles avaient égarée et qui leur permet de reconstruire une confiance altérée par la crise et les investissements spéculatifs bien éloignés des préoccupations des sociétaires. La reconquête passe, et ne pourra que passer par le fait de retisser du lien avec les sociétaires, regagner les positions de proximité qui faisaient des banques coopératives, et des coopératives dans leur ensemble, la base de leur légitimité. Au plus proche des sociétaires, de leurs besoins, de leurs attentes et de leur vote. Ces organisations retrouvent ou redécouvrent une part de leur identité, celle-ci est également réappropriée par les individus. Une banque qui appartient à ses clients laisse l'opportunité de devenir acteur de sa banque. Même si les normes et la professionnalisation des métiers en appellent à plus d'implication de salariés professionnels, ces organisations laissent l’opportunité pour des individus de se réinvestir dans des projets « collectifs ». Il est étonnant, d'ailleurs, que dans ce qu'il est désormais courant de qualifier de "révolution collaborative", au travers le Crowdfunding, l'appel direct au public ou encore Wikipedia, que les banques coopératives en soient restées éloignées alors que cette forme de coopération correspond largement à l'identité coopérative (Juvin, 2013).
Si un élément est à retenir dans l’économie sociale, c’est bien la gestion collective d’un projet, ce qui nous amène à souligner combien le retour de la démocratie dans l’économie peut avoir d’avantages. Si elle n'est pas parfaite, elle demeure le mécanisme de protection des intérêts de chacun et de l'expression de tous.
[1] Birchall J. et Ketilson L. H., 2009, Resilience of the cooperative business model in time of crisis, International Labour Organization.
[2] "Coopératives financières: un pari sûr en période de crise", analyse du 12 avril 2013, site Internet du BIT, in http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_210354/lang--fr/index.htm (Page consultée le 26 février 2014).
[3] International cooperative alliance, cooperative identity, values and principles, in http://ica.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles
[4] Master of Management, Co-operatives and Credit Unions de l'université Saint Mary's et de l'école de management Sobey au Canada, ou le Master Gouvernance Mutualiste de l'Universite de Versailles-Saint Quentin en France.